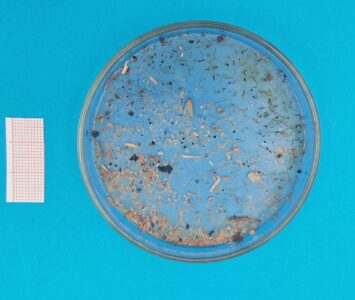En bio depuis 4 ans en Côtes d’Armor, Gaëtan Dauphin cultive tomate, concombre, mâche et pomme de terre, avec son épouse sur 7 000 m2 de serres chapelle double paroi. Président de la section sous abris bio du Cerafel, il prône le respect de l’agronomie et une approche technico-économique plus extensive.
…
Cet article n'est pas accessible publiquement.
Connectez-vous pour accéder à ce contenu.